
Après les soulèvements populaires doit s’amorcer un processus révolutionnaire pour empêcher toute forme de retour à la normale.
Depuis trois ans, des révoltes embrasent le monde. Il n’en faut pas moins aux éditions La Fabrique pour reprendre le ton insurrectionnaliste du best seller L’insurrection qui vient. Cette fois-ci, c’est Éric Hazan lui-même qui tient la plume, accompagné d’un mystérieux Kamo. Pourtant, ce nouveau livre reprend la recette qui a fait le succès du Comité invisible. Un format court et un style vif.
« Ce texte se propose humblement de rouvrir la question révolutionnaire », présentent Éric Hazan et Kamo.
Ce projet ambitieux semble néanmoins mal engagé avec un inventaire dans lequel les conseils ouvriers côtoient la dictature du prolétariat. Donc deux conceptions radicalement opposées de la politique entretiennent la confusion autour du terme « révolutionnaire ». Mais le livre permet de s’extraire d’une tradition contestataire désormais incontournable : le programme politique avec ses réformettes bien ficelées.
Ce texte pose des questions indispensables. « Quels moyens mettre en œuvre afin de devenir ingouvernables et, surtout, de le rester ? Comment faire en sorte qu’au lendemain de l’insurrection la situation ne se referme pas, que la liberté retrouvée s’étende au lieu de régresser fatalement – en d’autres termes, quels ont les moyens adéquats à nos fins ? », interrogent Éric Hazan et Kamo. La pertinence de ses questions s’éclaire d’autant plus au regard de l’effondrement des révoltes dans les pays arabes et ailleurs.

La rupture avec l’existant
Kamo et l’auteur de LQR attaquent les concepts qui maintiennent l’ordre social. La démocratie ne peut s’appuyer que sur l’affirmation du suffrage universel comme seule légitimité. Les « marchés », désormais personnalisés, imposent une vision du monde en faveur de la finance et des possédants. La collusion entre l’État et les marchés semble incarnée par les inspecteurs des finances, ses hauts fonctionnaires qui n’hésitent pas à se mettre au service des entreprises. La crise s’apparente également à un discours qui permet de renforcer le pouvoir des patrons. « Or, ce que l’on appelle crise est un outil politique essentiel pour la gestion des populations aussi bien productives que surnuméraires », observent Éric Hazan et Kamo. Les bureaucrates et le « personnel politique » se contentent de gérer l’ordre existant et de faire accepter les décisions au peuple.
La gauche et l’extrême gauche se gardent bien d’attaquer le capitalisme démocratique. L’oppression marchande doit être seulement régulée et encadrée pour devenir plus vivable et plus morale. « Nulle part il n’est question de lui faire subir le même sort qu’on connu par le passé bien des régimes d’oppression, de lui donner une bonne fois congé, et pour toujours », déplorent Éric Hazan et Kamo. Les partis et les intellectuels refusent toujours d’évoquer une perspective de rupture révolutionnaire.
Le texte devient plus contestable lorsqu’il relativise l’importance de l’aliénation et de la destruction des relations humaines. Il reprend le refrain de la deuxième partie de L’insurrection qui vient pour prophétiser une onde de choc qui devrait inéluctablement embraser la planète. Ce discours sympathique estime qu’il suffit de parler de révolution pour la faire advenir. Mais les auteurs insistent pertinemment sur l’indispensable analyse des échecs historiques. « On ne se dirige pas dans une époque sans avoir appris des échecs révolutionnaires, ceux qui ont entraîné les défaites et plus encore ceux qui ont suivi les victoires », soulignent Éric Hazan et Kamo.
Dans l’histoire de France comme dans les pays arabes les révolutions populaires sont suivies de gouvernements provisoires et d’élections qui visent à enterrer la révolte.
C’est l’idée d’une période de transition qui enterre toute forme de révolution. Lorsque la machine bureaucratique continue de fonctionner, la révolte se retrouve étouffée. Mais une autre démarche peut émerger. « Ce dont il s’agit ici n’est pas de rédiger un programme mais de tracer des pistes, de suggérer des exemples, de proposer des idées pour créer immédiatement l’irréversible », précisent Éric Hazan et Kamo. C’est souvent la peur du chaos et de l’inconnu qui favorise le retour à la normale. Dans un processus de révolution, le fonctionnement de la bureaucratie doit être paralysé. Les réunions doivent être bloquées. « Nous couperons leurs lignes de communication, leur intranet, leurs listes de diffusion, leurs lignes téléphoniques sécurisées », proposent Éric Hazan et Kamo. Il ne faut pas prendre les lieux du pouvoir mais les bloquer.

L’abolition de l’ordre marchand
La révolution passe par une abolition du travail. D’ailleurs, plus personne ne croît aux discours creux sur la ré-industrialisation ou le retour au plein emploi. Mais la transformation sociale doit surtout réinventer tous les aspects de la vie. « Une situation révolutionnaire ne se résume pas à une réorganisation de la société. C’est aussi, c’est surtout l’émergence d’une nouvelle idée de la vie, d’une nouvelle disposition à la joie », soulignent Éric Hazan et Kamo. L’activité humaine ne doit plus reposer sur la contrainte du travail mais sur le désir et le plaisir.
« Ce qui peut, ce qui doit être fait au lendemain de l’insurrection, c’est disjoindre travail et possibilité d’exister, c’est abolir la nécessité individuelle de « gagner sa vie » », soulignent Éric Hazan et Kamo. Cette nouvelle manière de vivre doit sortir des rapports sociaux capitalistes, avec l’argent comme intermédiaire des relations humaines. Les moments de révolte, sur la place Tahir ou en Mai 68, dessinent cette nouvelle possibilité d’existence. Ce sont ses mouvements de lutte, à la base, qui doit construire la nouvelle société. « L’abolition de l’économie n’est pas quelque chose qui se décrète, c’est quelque chose qui se construit, de proche en proche », précisent Éric Hazan et Kamo.
L’abolition de l’argent passe surtout par la généralisation de la gratuité, à commencer par la nourriture et le logement. L’appropriation devient alors inutile et ridicule lorsque les besoins essentiels deviennent accessibles à tous. La fausse bonne idée du revenu universel, prônée notamment par Toni Negri, ne remet pas en cause l’ordre social et ne fait qu’aménager la misère existentielle. « Il maintient cela même que le processus révolutionnaire doit abolir : la centralité de l’argent pour vivre, l’individualisation du revenu, l’isolation de chacun face à ses besoins, l’absence de vie commune », analysent Éric Hazan et Kamo. L’économie, dès ses origines, permet d’asservir les individus à la puissance matérielle du souverain. L’économie s’apparente à une science de contrôle des esclaves. La valeur marchande n’est que le moyen de cet asservissement pour quantifier et contrôler l’activité des esclaves. Le règne de l’évaluation et de la quantification révèle l’emprise du capitalisme jusque sur nos corps et sur nos vies. L’économie ne doit donc pas être régulée ou encadrée mais supprimée. « L’abolition du capitalisme, c’est avant tout l’abolition de l’économie, la fin de la mesure, de l’impérialisme de la mesure », soulignent Éric Hazan et Kamo.
Le travail demeure une activité vide de sens et aliénante, qui dépossède les individus de la conduite de leur vie. Les activités indispensables ne doivent pas se faire dans la contrainte, mais dans le plaisir de la rencontre et de la vie collective.
« La fin du travail obligatoire, la fin de la dictature de l’économie auront pour conséquence quasi mécanique la fin de l’État », soulignent Éric Hazan et Kamo. Pendant les moments révolutionnaires, la vie s’organise sans la nécessité d’un État ou d’une quelconque direction centrale. L’appareil d’État ne sert à rien, sinon à sa propre reproduction. La priorité des politiciens demeure leur réélection. Surtout, l’État éloigne le peuple de la prise de décision. Les intérêts des politiciens convergent avec ceux des capitalistes pour maintenir le bon fonctionnement de l’ordre social.
Le pouvoir central doit disparaître au profit d’assemblées. Mais ses organisations doivent se défaire des tares du parlementarisme et de la politique bourgeoise. En revanche, les exemples donnés par le texte semblent peu convaincants. Le « bar-épicerie » de Tarnac, petite entreprise de pseudo-contestation, et la bureaucratie « autogérée » de Marinaleda, avec son « maire réélu sans discontinuer depuis trente ans », sont présentés comme des modèles. L’autogestion du capitalisme et de la misère existentielle ne sont évidemment pas des solutions acceptables. L’abolition des relations marchandes n’est d’ailleurs pas clairement envisagée dans ses « modèles ».

Réinventer la vie
La révolution ne doit pas craindre le désordre et le conflit pour expérimenter de nouvelles manières de vivre. Cette démarche s’oppose à la dépossession de la conduite de nos vies. « L’irréversible, c’est de restaurer la prise que les humains ont perdu sur leurs conditions immédiates d’existence », soulignent Éric Hazan et Kamo. La satisfaction des besoins ne peut s’organiser qu’à l’échelle locale. Le processus révolutionnaire ne peut pas se limiter à une simple « appropriation collective » des moyens de production. Ce sont tous les aspects de la vie qui doivent être réinventés.
Internet et les réseaux sociaux doivent également être critiqués. Les sites de rencontres révèlent également l’isolement et la misère existentielle. Pour Éric Hazan et Kamo, « jamais un tel système ne remplacera la palabre, le contact avec les yeux et les mains, les verres bus en commun, l’enthousiasme et les disputes, les véritables « rapports sociaux » qui ne sont pas du domaine de la sociologie mais de l’amitié ».
Le processus révolutionnaire doit permettre, contre la culture conformiste et standardisée, une libération de la créativité.
Un nouveau fascisme émerge dans une Europe en crise. Les idées racistes se banalisent. Mais l’antifascisme relève de l’imposture car, sous couvert de lutter contre l’extrême-droite, il semble défendre la démocratie libérale. « C’est la poussée révolutionnaire, l’éveil fraternel de toutes les énergies comme dit Rimbaud, qui renverra les apprentis fascistes à leur néant », tranchent Éric Hazan et Kamo.
Les auteurs appellent à l’organisation pour permettre aux révoltes de se coordonner et de se radicaliser. Cette organisation est évidemment différente de la forme Parti qui ne fascine encore que les débris du bolchevisme. « S’organiser, c’est faire évoluer des groupes en constellations subversives par le jeu des amitiés, des espoirs partagés, des luttes menées en commun, de proche en proche », précisent Éric Hazan et Kamo.
Ce livre semble plus accessible que L’insurrection qui vient. Surtout, il semble plus précis sur le processus de rupture révolutionnaire. Il propose des pistes de réflexion qui vont au-delà du constat. Sur ce point, il semble plus précis que le Comité invisible qui se contente d’un blanquisme relooké. Ce texte permet d’ouvrir un indispensable débat sur les perspectives révolutionnaires.
Cependant, les références historiques du texte d’Éric Hazan et Kamo ne sont pas toujours très libertaires. La Révolution française, et son jacobinisme frelaté, demeure la référence majeure. Les mouvements libertaires et le communisme de conseils ne sont pas évoqués. Ses Premières mesures révolutionnaires n’attaquent donc pas clairement les dérives bureaucratiques et autoritaires des révoltes sociales.
Ses quelques pistes de réflexion se révèlent trop souvent déconnectées des luttes sociales et des expériences d’auto-émancipation du prolétariat. Tarnac et Marinaleda demeurent les seuls exemples concrets et se révèlent pourtant très limités. Ses lieux ne font que se confectionner un nid douillet à l’intérieur de la société marchande.
Pourtant, ce texte va également au-delà des pleurnicheries gauchistes. Il évoque la perspective d’une rupture révolutionnaire. Surtout il s’attache à un processus de transformation qualitative de la vie. La force du Comité invisible réside dans sa description de l’atomisation des relations humaines. Éric Hazan et Kamo prennent en compte cet aspect, toujours délaissé par les gauchistes de tous bords.
La révolution doit permettre de transformer le monde pour changer la vie.
Source : Éric Hazan & Kamo, Premières mesures révolutionnaires, La Fabrique, 2013
Articles liés :
Vers un renouveau de la pensée critique
Pressions et gestes pour agir contre le capital
Fissurer l’emprise du capital sur la vie
Créer des communautés contre le capitalisme
La grève illimitée, une ouverture des possibles
Pour aller plus loin :
Un entretien audio d’Alternative Libertaire avec Eric Hazan : Dialogue autour de « Premières mesures révolutionnaires » par Théo Rival (AL Orléans), Jean-Yves Lesage (AL 93) et Guillaume Davranche (AL Montreui), publié sur le site d’Alternative Libertaire le 7 octobre 2013
Radio : émisson Là-bas si j’y suis du 2 octobre 2013
Vidéo : « Eric hazan et l’insurrection, d@ns le texte« , diffusée sur le site Arrêt sur image le 5 mai 2009
Vidéo : Camille Polloni et Aurélie Champagne, Eric Hazan : « La révolution n’est pas terminée », publié le 9 septembre 2012 sur le site Rue 89 (Vidéo intégrale de l’entretien)
J.-C. Martin, « De la révolte comme d’un art appliqué aux barricades / Hazan, Kamo, Zizek, Horvat« , publié sur le site Strass de la philosophie le 6 septembre 2013
Simon Labrecque, « Critique de Premières mesures révolutionnaires« , publié sur le site Trahir le 8 septembre 2013
Conversation avec Eduardo Colombo, « Lorsque le projet n’existe pas, le geste de la révolte devient répétitif« , publié le 16 mai 2013 sur le site de l’Organisation communiste libertaire (OCL)

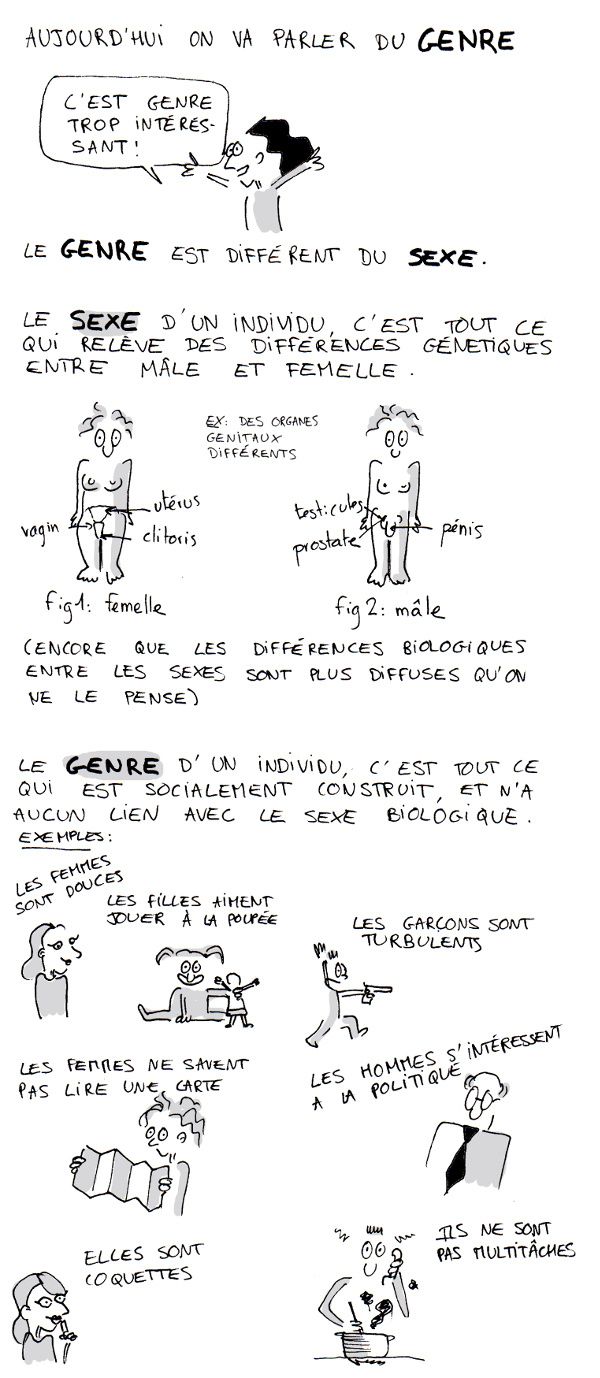



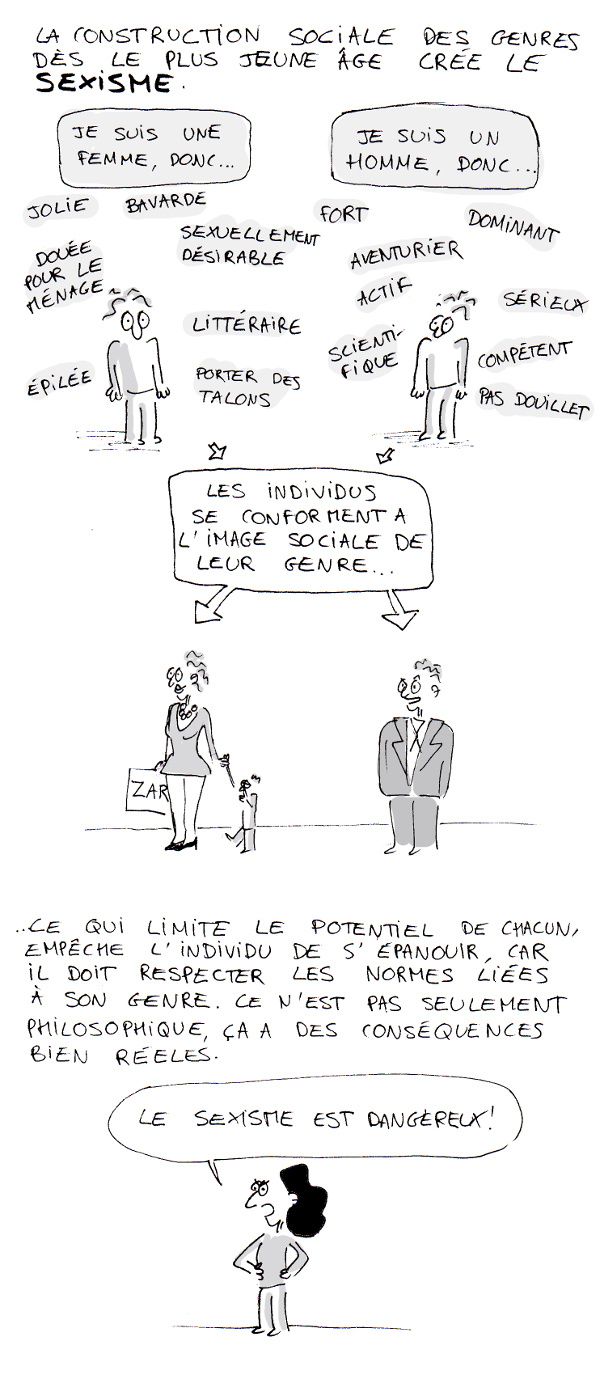













 L’assassinat de Clément Meric, jeune antifasciste parisien, par ailleurs décrit comme anarchiste et vegan, n’est pas -comme on a pu le lire un peu partout- uniquement le fait de la “violence” des “groupes d’extrême-droite” ou le résultat d’une “rixe”, et moins encore un “fait divers”. C’est un meurtre avec une motivation politique, fruit d’un climat et d’une dynamique amorcée il y a déjà un moment. Climat qui est conforté par l’actuel gouvernement (et les précédents) qui premièrement laisse la part belle à des mouvements réactionnaires, hétéro-patriarcaux et fascisants du type “printemps français” ou de la “manif pour tous”, mais d’autre part cultive depuis des années une répression féroce contre toute initiative révolutionnaire, et un violence oppressive simplement “trop commune” contre les pauvres en général ou encore contre les immigré-e-s.
L’assassinat de Clément Meric, jeune antifasciste parisien, par ailleurs décrit comme anarchiste et vegan, n’est pas -comme on a pu le lire un peu partout- uniquement le fait de la “violence” des “groupes d’extrême-droite” ou le résultat d’une “rixe”, et moins encore un “fait divers”. C’est un meurtre avec une motivation politique, fruit d’un climat et d’une dynamique amorcée il y a déjà un moment. Climat qui est conforté par l’actuel gouvernement (et les précédents) qui premièrement laisse la part belle à des mouvements réactionnaires, hétéro-patriarcaux et fascisants du type “printemps français” ou de la “manif pour tous”, mais d’autre part cultive depuis des années une répression féroce contre toute initiative révolutionnaire, et un violence oppressive simplement “trop commune” contre les pauvres en général ou encore contre les immigré-e-s.




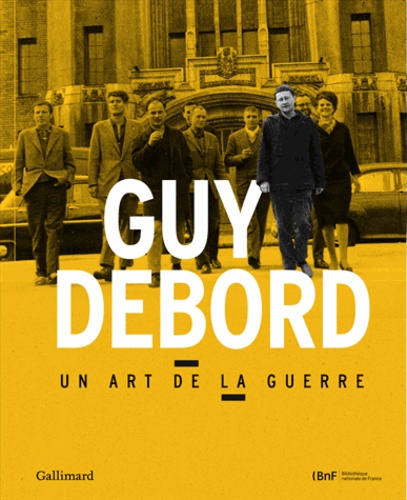

 Sponsorisé par Microsoft
Sponsorisé par Microsoft