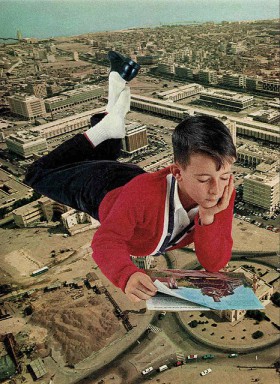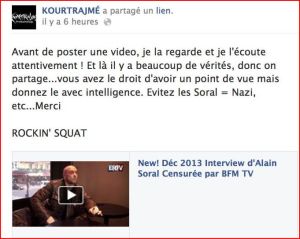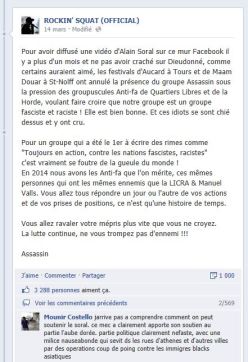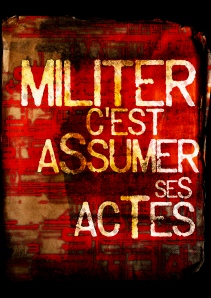Lorsqu’en 1968, les futurs membres de la « League of Revolutionary Black Workers » prirent le contrôle du journal étudiant de Wayne State, ils ajoutèrent à l’en-tête le slogan suivant : « Un ouvrier conscient vaut cent étudiants. »1 Ce genre d’arithmétique politique est aujourd’hui devenu beaucoup plus difficile. Non pas qu’il ne soit pas tenté ; on peut imaginer entendre « une infirmière syndiquée vaut cent serveuses. » Mais le calcul ne tient pas debout. La formule originelle a étéavancée dans le Detroit industriel, dont l’industrie automobile représentait l’avant-garde du développement capitaliste mondial. Detroit est désormais en faillite, et la gauche marxiste semble osciller entre la répétition des vieilles formules et leur démenti apocalyptique.
Il nous faut donc revenir au problème que cette formule était censéerésoudre : celui de la manière dont les catégories de classe se situent dans le développement capitaliste et dont elles peuvent être transformées en un sujet politique. La pratique de l’enquête ouvrière a toujours représenté une tentative de résolution de ce problème, et pour l’operaïsme italien, c’est le concept de composition de classe qui devait orienter ces recherches.
Dans Ouvriers et capital, Mario Tronti fonde la composition de classe sur la théorie de la valeur de Marx. Il commence par rappeler la thèse de Marx dans le livre II du Capital, selon laquelle le rapport de classe n’apparaît pas dans l’atelier, mais est déjà contenu dans l’échange central entre l’argent et la force de travail. Cet échange présuppose qu’un prolétaire dépossédé des conditions de travail rencontre le propriétaire d’argent sur le marché2.
Mais l’achat et la vente de la force de travail déclenchent une dynamique de recomposition. Le capitaliste individuel doit en effet rassembler une multiplicité de forces individuelles de travail pour constituer un force productive coopérative. Les prolétaires atomisés sont ainsi recomposés enclasse ouvrière collective. Or, dès que cette force productive est incorporée au capital, comme le ferment actif de la valorisation de la valeur, elle devient un agent antagoniste. La classe ouvrière résiste à sa réduction au statut de force de travail, même si cette résistance prend des formes totalement passives. Quand elle prend la forme d’une résistance à la journée de travail, les capitalistes sont forcés d’agir collectivement en tant que classe, pour protéger les conditions d’accumulation que leur concurrence pourrait par ailleurs saper. Ainsi, en limitant légalement la journée de travail, l’Etat capitaliste empêche l’exploitation, qui tend à écraser les corps de la classe ouvrière, de détruire ses propres conditions de possibilité. Mais cette dynamique force également les capitalistes à s’engager dans un bond technologique en avant de manière à renouveler l’accumulation; et cette revolutionarisation du procès de production est identiquement recomposition de la force productive de la force de travail à un niveau technologique plus élevé. Les enquêtes ouvrières menées, entre autres, par Romano Alquati, représentent une tentative d’analyse de la nature de cette force de travail technologiquement recomposée et de ses refus politiques.
La dynamique précédemment décrite correspond à la composition de classe sur le plan de laconstitution sociale. Elle est logiquement suivie par la composition de classe sur le plan de l’organisation. C’est cette question des formes organisationnelles qu’en 1967, Bologna met au cœur de ce qui est sans doute le texte le plus célèbre sur le concept de composition de classe, « composition de classe et théorie du parti aux origines du mouvement des conseils ouvriers ».
Dans ce texte, le rapport entre la constitution de la force de travail et son refus antagoniste est exprimé par le rapport entre les compositions « technique » et « politique » de la classe ouvrière. Bologna se concentre sur une composition technique spécifique à l’Allemagne du début du vingtième siècle: celle de « l’ouvrier professionnalisé », l’ouvrier qualifié opérant sur des machine-outils et attaché à son métier. Il cherche à montrer que malgré son caractère conservateur (protection d’une aristocratie ouvrière contre l’innovation technique, revendication de la position et de la fonction de producteur) le projet autogestionnaire avait néanmoins un caractère révolutionnaire dans la conjoncture au sein de laquelle il intervenait. En bloquant la tentative des employeurs d’augmenter la composition organique du capital, les conseils ouvriers ont représenté un obstacle fondamental à l’accumulation. Il a donc non seulement fallu les briser par la force politique, mais le capital a en outre été contraint de décomposer l’ouvrier professionnalisé. Le Taylorisme a ainsi été introduit en Allemagne après le deuxième guerre mondiale pour répondre au défi des conseils, en cassant l’ouvrier professionnalisé et en recomposant la classe ouvrière sous la forme du « travailleur à la chaîne déqualifié, déraciné, très mobile, et interchangeable. » Cet « ouvrier-masse » pouvait être soumis à un niveau plus élevé d’automation, mais il pouvait aussi avancer de nouvelles formes politiques organisées autour des luttes salariales, lesquelles définissent le cadre de la période étudiée par Bologna3.
Or, il y a au moins deux façons d’interpréter cette dynamique. Une première décrit les formes d’organisation comme autant de réponses stratégiques de la classe ouvrière à des moments déterminés du développement capitaliste. Elle reconduit corrélativement les réactions du capital à la perturbation que représente l’antagonisme ouvrier organisé. Quoique fluctuants, ces processus sont constitutifs l’un de l’autre, ils s’entre-limitent et ouvrent de nouvelles trajectoires pour leur développement respectif4.
Pour la seconde interprétation, en revanche, ces processus peuvent être compris comme autant d’étapes vers la réalisation d’un but historique, soumis à une « periodisation. » L’ouvrier professionnalisé aurait ainsi été dépassé par l’ouvrier-masse afin de réaliser l’abstraction complète du travail – autrement dit, afin d’assurer le plein développement du capital et de la subjectivité de la classe ouvrière. L’hégémonie du secteur avancé de la classe ouvrière sert de garantie au déroulement de ce processus historique. La composition de classe se transforme alors en théorie téléologique del’expression de la composition technique en composition politique.
Cette lecture n’est pas sans précédent chez Marx. Comme le souligne Toni Negri, on trouve un aperçu de ce déroulement historique de l’abstraction dans les Grundrisse, mais il passe à l’arrière-plan dans l’exposition scientifique et empirique du Capital. Bologna, qui semble préférer l’exposition scientifique et empirique, devait plus tard sévèrement critiquer cette deuxième interprétation, à la fois comme lecture de son propre travail et comme cadre d’analyse des nouvelles figures hégémoniques. Mais son texte ne propose pas d’alternative théorique, et la periodisation qu’il propose ne permet pas d’expliquer certains secteurs de la classe ouvrière allemande, qui, à l’instar des mineurs de la Ruhr, ne sauraient être assimilés à la composition de l’ouvrier professionnalisé5.
Il est à cet égard frappant de constater qu’alors même qu’il souligne le« pouvoir ouvrier de provoquer la crise et de geler le développement capitaliste » qu’ont exercé les conseils, Bologna ne mentionne pas le débat sur la théorie de l’effondrement mené au sein du mouvement conseilliste allemand. Pour la majorité des communistes de conseils qui se sont séparés du Parti communiste pour fonder le KAPD en 1920, l’imminence de la crise terminale conférait aux luttes économiques spontanées un caractère directement révolutionnaire. Mais les implications politiques de cette théorie ne furent pas discutées en profondeur avant 1929, quand Wall Street s’est écroulé alors qu’ Henryk Grossman venait de présenter une nouvelle théorie de la crise fondée sur « la loi de la baisse tendancielle du taux de profit. »
Cinq ans plus tôt, l’économiste allemand Erich Preiser avait affirmé que :
les parallèles avec la philosophie hégélienne de l’histoire ne sont nulle part plus clairs que dans la loi de la baisse tendancielle du taux de profit6.
Il revient à Paul Mattick, un participant de la Révolution allemande transplanté aux États-unis à partir des années 1920, d’avoir intégré cette philosophie de l’histoire au communisme des conseils. Mattick s’est appuyé sur la thèse avancée par Grossman d’une accéleration des crises cycliques pour prévoir « la crise permanente, ou crise mortelle du capitalisme », au cours de laquelle le capital, dans une ultime tentative de récupérer ses profits, engagerait un assaut frontal contre la classe ouvrière. Il écrit :
C’est seulement lorsque le prolétariat connaît un processus nécessaire de paupérisation absolue que les conditions objectives sont mûres pour un mouvement authentiquement révolutionnaire7.
À vrai dire, pour Mattick, cette stricte condition de l’action révolutionnaire remettait en question la signification politique des conseils allemands. Leur défaite aurait finalement démontré que :
la lutte du prolétariat allemand de 1912 à 1923 est apparue comme un ensemble de frictions mineures accompagnant le processus de réorganisation capitaliste8.
Cependant, au sein du mouvement international des conseils, tous ne souscrivaient pas à cette eschatologie pour laquelle les luttes de classe précédant l’effondrement sont autant de chaises longues sur le Titanic. Karl Korsch remarque ainsi que :
la théorie d’une tendance économique de développement objectivement donnée, dont le but peut être saisi en avance, emploie des images au lieu de concepts scientifiques explicitement déterminés9
Anton Pannekoek a quant à lui critiqué la théorie de l’effondrement en profondeur. Ayant présenté une réfutation mathématique de l’argument de Grossman, il s’est concentré sur le rapport théorique entre l’opération objective des lois économique et l’action subjective de la classe ouvrière. La conception de Grossman selon laquelle la révolution s’imposerait par une catastrophe économique ne laisse guère de place au développement de la « maturité révolutionnaire » de la classe ouvrière, maturité qui, si elle est généralement acquise au cours des luttes salariales, exige en fin de compte de « nouvelles formes de lutte. » La théorie de Grossman n’exprimerait ainsi que la vision des intellectuels, prêts à se présenter comme un « nouveau pouvoir gouvernant » lorsque le vieux monde se sera écroulé10.
Bref, le mouvement des conseils a bel et bien posé la question du rapport entre crise et révolution. Mais dans la théorie avancée par Grossman et Mattick, il a également réduit cette relation incertaine à la nécessité historique de l’effondrement. Il n’est dès lors pas surprenant que la théorie de la crise n’est pas été intégrée à l’analyse du caractère concret de la classe ouvrière. En fait, pour Grossman et Mattick, le développement technologique exprime simplement la relation transhistorique des être humains à leurs outils11. Sans une conception historiquement déterminée de la marchandise force de travail ou de l’impératif spécifiquement capitaliste de développement technologique, il est impossible de rendre compte de la manière dont le changement technique transforme l’existence concrète de la force de travail.
De l’autre côté, bien que Korsch et Pannekoek aient avancé une critique perspicace des présupposés téléologiques de la théorie de l’effondrement, ils furent incapables de proposer une analyse alternative du rapport entre les catégories économiques objectives et l’organisation révolutionnaire. Pour Pannekoek, la subjectivité politique peut en effet être réduite à un processus de « développement spirituel12. » Dans cette perspective, la forme-conseil, plutôt qu’une réponse politique à un niveau spécifique de développement capitaliste, ne représenterait rien d’autre que le « destin » d’une classe ouvrière appelée à gérer la production.
Notons que ces débats sur l’effondrement eurent lieu juste avant le plus long boom dans l’histoire du capitalisme. Mattick maintint tout au long de ce boom que les contradictions internes du capitalisme le propulsaient encore et toujours vers l’effondrement. La réponse de l’operaïsme, quant à elle, s’est développée dans une toute autre direction. Tronti rejete en effet explicitement toute théorie de l’effondrement, et insiste sur les moments de stabilisation cyclique qui suivent les crises économiques. Soutenant fermement que les luttes salariales ne sauraient mener à une crise catastrophique de profitabilité, il souligne néanmoins que ces luttes, dans la mesure où elles représentent le refus de la classe ouvrière d’être constituée en force de travail, peuvent provoquer une crise politique :
le maillon de la chaîne où se produira la rupture ne sera pas celui où le capital est le plus faible mais celui où la classe ouvrière est la plus forte13.
La révolution émergerait ainsi au point où la classe ouvrière pourrait contraindre le capital à un plus haut niveau de développement, et où son parti pourrait entraîner un rupture avec ce développement : Lénine en Angleterre. Le développement politique le plus avancé de la classe ouvrière est alors l’ouvrier-masse, dont Bologna a retracé les origines dans la réponse capitaliste aux conseils14.
Vinrent alors les années 1970 ; le développement capitaliste fonça tête baissée dans une nouvelle crise économique, et l’usine perdit de sa centralité dans les conflits sociaux. C’est dans ce contexte que des figures comme Bologna et Negri réactivèrent l’orthodoxe « baisse tendancielle du taux de profit. » Mais il s’agissait là d’une tentative réelle d’interprétation de la crise politique sur le base d’une conception dynamique de la force de travail15. Mettons donc entre parenthèse les détails techniques de ces débats renouvelés sur la théorie de la crise, ainsi que ceux qui concernent les mécanismes causaux à l’oeuvre derrière le déclin du boom d’après guerre, et concentrons-nous sur le rapport entre crise et composition de classe.
Dans un contexte marqué par l’augmentation du chômage et l’émergence des nouveaux mouvements sociaux, Negri a ambitieusement tenté de repenser le sujet révolutionnaire en proposant une nouvelle figure hégémonique: l’ouvrier socialisé. Les détails précis de cette théorie ont été largement critiqué par, entre autres, les operaïstes, mais la critique doit porter à un niveau conceptuel plus fondamental : ce qui est resté ininterrogé, c’est en effet la prémisse même d’une figure hégémonique de la classe ouvrière, d’une avant-garde ouvrière coincidant avec le « secteur avancé » de la production capitaliste.
Bologna et les contributeurs de son journal Primo Maggio ont quant à eux exploré une approche alternative, en revenant à l’enquête ouvrière. Leurs enquêtes sur la restructuration dans l’industrie automobile, surtout celles menées par Marco Revelli chez FIAT, se concentrent sur la stratégie de crise mise en place par le capital pendant les années 1970. On rencontre ici tous les termes qui nous sont devenus familiers: diversification, financiarisation, décentralisation, et délocalisation. Il s’agissait en même temps d’un processus de recomposition de la classe ouvrière, représenté par l’automation, la tertiarisation, et l’embauche d’une jeune génération d’ouvriers. Les licenciements massifs furent suivis par la robotisation accélérée du procès de production, non seulement comme facteur d’augmentation de la productivité, mais aussi comme mesure disciplinaire16.
Cette recomposition a également été marquée par une féminisation de la main-d’œuvre, encouragée par de nouvelles lois promouvant l’embauche des femmes. Comme le souligne Alisa Del Re, l’entrée des femmes sur le marché du travail salarié a été motivée par la « précarité d’accès aux moyens de survie. » L’inflation avait directement touché les femmes, qui géraient la consommation des ménages, et elle les a contrainte à occuper le « double poste de travail » du travail salarié et du travail domestique de reproduction17.
En octobre 1980, cette décennie de lutte de classe et de restructuration culmine dans une grève de cinq semaines contre les licenciements, rapportée par Revelli dans l’article « Les ouvriers de FIAT et les autres. » L’échec de la grève est dû à l’expression sans précédent d’un fort sentiment anti-ouvrier : les 10-15 000 travailleurs en grève durent en effet faire face à 20-40 000 cadres moyens, chefs d’équipe, et employés de bureau défendant, lors d’une contre-manifestation, leur « droit de travailler ». Pour Revelli, il s’agit là d’une « décomposition extrême de la classe » provoquée par « l’insécurité planifiée promue par le capital » ayant mené les « couches moyennes » à « offrir leur loyauté en échange de la sécurité. »
C’est pourquoi il était temps, selon Revelli, de réviser l’analyse « schématique » des compositions de classe unitaires pouvant faire l’objet d’une périodisation par étapes nettement délimitées. En fait, c’est l’hétérogénéité qui caractérise l’histoire globale du mouvement ouvrier. Les expériences de luttes passées se communiquent aux secteurs émergents, construisant ainsi des réseaux qui permettent de nouvelles luttes. L’ouvrier-masse n’a pas été dépassé par les mouvements des étudiants et de la jeunesse; les deux figures de classe étaient articulées de manières complexes, irréductibles à l’hégémonie de l’une ou l’autre. Comme l’écrit Revelli :
Le jeune prolétariat métropolitain peut aller « au-delà » du travail précisément parce que […] la région qui s’étend derrière la ligne de front est défendue par une puissance ouvrière qui a été moulé et formé par le travail.
Mais maintenant que cette défense a été détruite par l’offensive des employeurs contre le front ouvrier, de quelle théorie de la composition de classe avons-nous besoin ? Il faut commencer par souligner que cette décomposition dépasse la stratégie capitaliste initialement décrite par l’operaïsme, qui consistait à briser le contrôle ouvrier pour introduire des machines économisant le travail. Revelli avait prévu que malgré l’informatisation de l’usine, le capital ralentirait son investissement en capital fixe et opterait à la place pour la surexploitation de la main-d’œuvre. Or, comme l’a récemment montré Kim Moody, c’est exactement là ce qui s’est passé aux États-unis pendant les années quatre-vingt : le « maillon brisé » entre l’augmentation du rendement de travail et le salaire est une des ruptures opérées par le néolibéralisme. La trajectoire typique du développement capitaliste implique certes la constitution de la force de travail au sein de formes de production techniquement de plus en plus avancées. Mais – conséquence paradoxale de l’énorme succès rencontré par le capital dans la lutte de classe qu’il a mené ces dernières décennies – lorsque « l’incitation à de grandes percées technologiques est émoussée par le déclin des coûts relatifs au travail » un aspect classique du développement capitaliste se trouve miné18.
Il faut néanmoins insister sur le fait qu’on est très loin d’un effondrement de type conseilliste, caractérisé par l’émergence de luttes spontannées « riches d’implications révolutionnaire19. » Nous sommes au contraire toujours confrontés à cette classe ouvrière défaite que décrivait Revelli. Elle n’est pas spontanément unifiée, et son potentiel antagonique est soumis à un nouveau régime disciplinaire. Ses comportements et ses identités n’expriment pas une composition de classe avancée, mais plutôt les divisions fondamentales de la précarité. La recherche d’une figure hégémonique de la classe ouvrière représente un obstacle à la compréhension de ces changements. Il nous faut bien plutôt poser une question qui ne pouvait pas l’être dans les débats classiques sur l’effondrement, et qui n’a jamais été clairement articulée dans l’operaïsme : si la composition de classe est interne aux rapports d’échange et au développement capitaliste, que signifie le fait que les crises du capitalisme décomposent le rapport de classe ? La réponse à cette question implique un retour à l’enquête – à une enquête militante sur la constitution inégale de la force de travail et les formes d’organisation susceptibles de répondre à la décomposition et la crise.













 Sponsorisé par Fortuneo
Sponsorisé par Fortuneo